L’art-thérapie prend tout son sens dans l’accompagnement des personnes endeuillées : pour se démêler de l’empêtrement des émotions, pour avoir des réponses ou des ouvertures par les images, pour se sentir entourés et compris, pour se remettre en mouvement et se sentir en vie.
Comment l’art thérapie vient faciliter une amorce dans le travail de deuil ?
Parler de ses peines, c’est déjà se consoler, nous disait Albert Camus.

Notre vie est faite “de bonjours” et “d’adieux”. Mais quelques-uns de ces adieux sont extrêmement douloureux… Ils nécessitent un travail de deuil. D’ailleurs, deuil en latin ne signifie-t-il pas souffrir ?
Dans cet article, je vous propose de suivre un conte Aani et Igasho (Aubinais, 2010), que j’ai divisé en cinq parties. Chacune de ces parties relate le chemin du deuil du héros Igasho et me permettra de vous raconter d’autres histoires de vie qui m’ont été confiées dans mon atelier d’art-thérapie.
Le quatre questions sur notre rapport à la mort
L’art-thérapie et le travail sur les émotions offrent une parenthèse bienveillante dans l’accompagnement des personnes endeuillées. J’entrevois un besoin de partir en quête de sens et de se ressentir à nouveau vivant grâce aux ressources créatives. Une manière de participer à sa propre réorganisation.
Pour certains, un deuil va durer quelques mois, pour d’autres ce sera quelques années.
Le processus de deuil est avant tout un processus de cicatrisation, qui se fait sur la durée, sans qu’on le décide. (Poletti, Dobbs, 2009)
Dix pourcents des deuils sont appelés pathologiques et nécessitent une grande pris en charge. Néanmoins, pathologiques ou non, un deuil est synonyme d’épreuve.
Alors comment faire face à cette souffrance ? Pouvons-nous nous y préparer ?
Nous pourrions peut-être commencer par nous poser ces quatre questions :
- Quelles sont mes peurs face à ma mort ?
- Quelles sont mes peurs face à la mort de mes proches ?
- Comment dessinerais-je la mort ?
- Comment est-ce que j’aimerais mourir ? (Quelle serait la “meilleure” mort pour moi ?)
Quatre questions intéressantes et pertinentes qui peuvent en dire long sur nos croyances et sur nos pensées, souvent inconscientes.

Quels symboles pour représenter la mort ?
Croiser la mort pour la première fois décape à tous les coups, nous dit Alexandre Jollien (2018). Nous pouvons aller plus loin en disant que le premier deuil colore toujours notre image de la Mort. Les suivants vont renforcer ou digérer la première expérience. Cela se situe entre la croyance et l’imaginaire. Selon Alix Noble Burnand, la croyance s’occupe de donner une explication complète et complexe sur l’origine de la vie, son déroulement, la mort et l’au-delà. Sa spécificité est de donner un sens à la vie et de servir de balise dans le tourbillon du présent. L’imaginaire, qu’il soit collectif ou individuel, permet à l’humain de créer des images indépendamment de la réalité et de ressentir les émotions que ces images véhiculent et suscitent.
Et vous ? Comment vous représentez-vous la Mort ? La Mort marraine ? La Grande Faucheuse ? La Mort fonctionnaire ? Un Vieillard ? Une créature ailée ? Une créature abstraite et répugnante ? Celle qui accompagne ou celle qui séduit ? La Mort qui questionne ? Le Néant ?
De mon côté, jusqu’à mes 30 ans, j’imaginais la Mort comme celle qui abîme, celle qui rend laid.
Le premier deuil que j’ai eu à faire est celui de mon grand-père préféré lorsque j’avais 5 ans. Ma mère m’a expliqué qu’il avait fait une attaque cérébrale et qu’il était aux soins intensifs. Lorsque j’ai demandé à lui rendre visite, elle a refusé et m’a répondu qu’il n’était pas beau à voir. Vous pouvez imaginer le raccourci que j’ai fait … il avait été attaqué et n’était plus beau à voir. Un dragon l’avait sûrement défiguré…
Inconsciemment, j’ai gardé cette image de dragon jusqu’à mes 30 ans, jusqu’à que je prenne le temps de répondre aux quatre questions du début de l’article.
Le concept en art thérapie
Au départ, pour accompagner les personnes endeuillées, j’avais concocté un concept de cinq ateliers sur une année.
Tout était prêt, équilibré, varié. Mon concept tenait compte de la difficulté des douze premiers mois, avec les premiers anniversaires sans la personne aimée, le premier Noël, les premières vacances. Mais les personnes qui m’ont contactée ont été demandeuses d’une thérapie brève. Dès lors, j’ai dû adapter ma façon de les accompagner. Jusqu’à présent, tous mes suivis ont duré entre une et quatre rencontres.
Comme les personnes viennent pour une thérapie brève, cela m’amène à travailler différemment. Parfois, en un atelier, les personnes devront découvrir un atelier d’art-thérapie (autant l’espace singulier que les règles intrinsèques), construire une relation de confiance avec la thérapeute, traverser les peurs liées à “est-ce que je saurai créer ?”, entrer dans le travail de symbolisation et accueillir tout ce qui advient dans le temps de parole.
Pas le temps d’évoquer tout le passé de la personne, ce que je vais lui proposer tend à développer ses propres ressources pour mieux affronter l’avenir à court terme. C’est une photographie du maintenant.
Le fait que ces thérapies soient brèves nécessite d’aller droit au but.
Le temps central du deuil
Le temps central du deuil est celui du vécu dépressif (Poletti, Dobbs). Long et douloureux, c’est une étape nécessaire qui montre que le travail du deuil se fait. Les sentiments de perte, de vide, de manque, de solitude, de chaos sont envahissants.
Il nous semble que le temps s’est arrêté. Créer un espace pour soi et se confronter à ce vide devient important. Il s’agit d’élaborer son absence grâce à la représentation vivante en soi de l’autre disparu (réellement ou symboliquement). (Klein) Lorsque nous créons en art-thérapie, nous sommes capables de symboliser la douleur et de la mettre côté pour quelques instants.
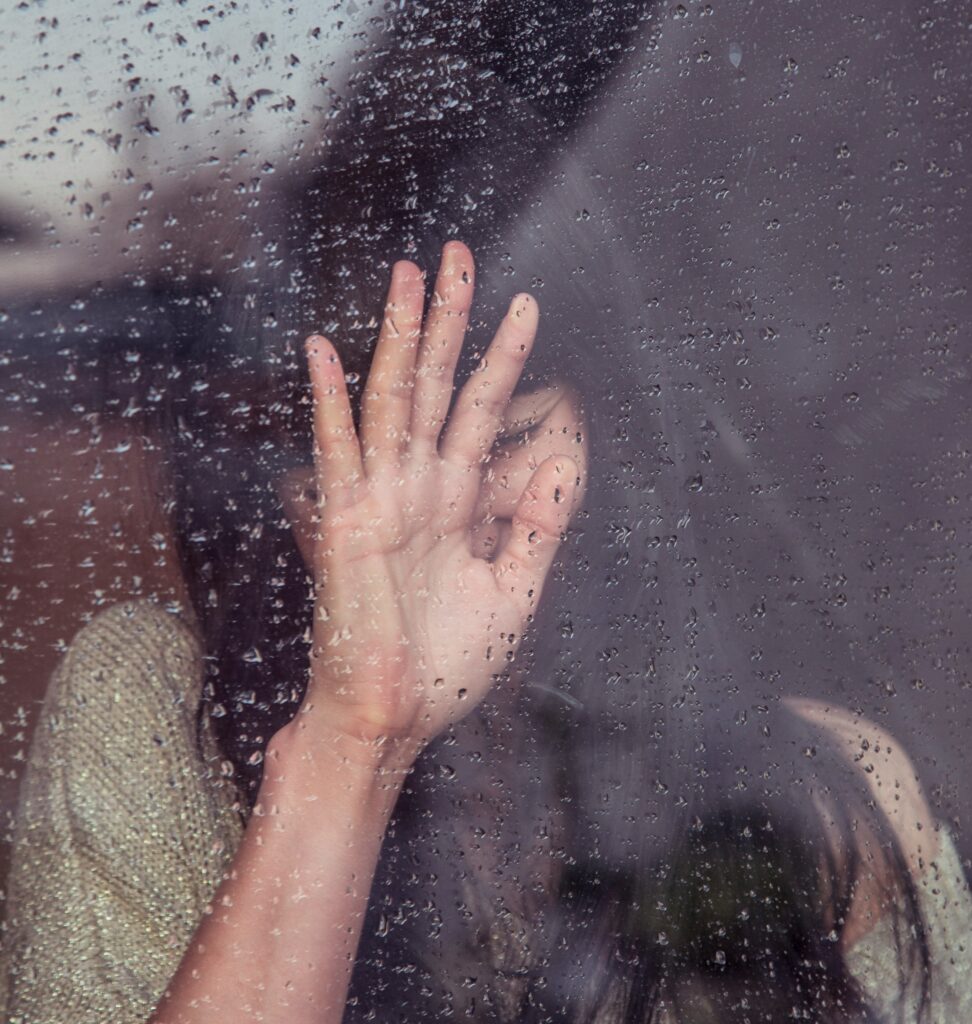
Puis, la personne va poursuivre seule son chemin du deuil, aidée par son entourage, par le temps qui passe, le temps qui guérit, le temps qui fait prendre de la distance… souvent.
Rosette Poletti le met en mot de cette façon : Plus rien ne sera comme avant. Mais petit à petit, la vie va s’infiltrer en vous par un rire d’enfant, un arc-en-ciel, un chant d’oiseau. Et vous passerez d’une relation extérieure à un lien profond à l’intérieur de vous. Cela permettra que l’autre existe en vous. (Poletti, Dobbs)
Gilles Deslaurier, quant à lui, insiste sur la notion de faire ses adieux d’une façon toute personnelle : il est étonnant de voir comment chacun trouve une façon adaptée à ses croyances et à ses valeurs pour prendre le temps de dire adieu… parfois à retardement.
Rosette Poletti et Barbara Dobbs relatent qu’ : une personne atteint la fin de son processus de deuil lorsqu’elle est capable de créer de nouveaux attachements et qu’elle peut évoquer la personne décédée sans souffrance émotionnelle. La tristesse restera jusqu’à un certain point, mais cette tristesse n’est plus aiguë.
L’acceptation de toucher le fond : Aani et Igasho (1)
Il était une fois, en Alaska, une jeune fille très belle appelée Aani. Tous les jeunes guerriers de sa tribu étaient amoureux d’elle et espéraient l’épouser. Mais Aani aimait depuis toujours le bel Igasho, qui venait d’être choisi comme nouveau chef de tribu.
Aani et Igasho décidèrent de se marier. On commença les préparatifs pour la fête, et les amoureux faisaient mille projets d’avenir. Mais une nuit Aani fut prise d’un malaise. Au petit matin, elle mourut, comme une flamme qui s’éteint.
Igasho fut inconsolable. Son esprit était sans cesse avec Aani. Quand il allait à la chasse, il regardait les caribous passer et il oubliait de sortir ses flèches. Il finit par ne plus aller chasser du tout, ni combattre. Assis près de la tombe de sa bien-aimée, il oublia de vivre, pour rêver à son bonheur perdu.
L’acceptation de toucher le fond en thérapie : François
Caché par les anciennes fermes du petit village d’Orny, mon atelier d’art-thérapie a ouvert ses portes en septembre 2014. Ce matin, je reçois François qui a 12 ans.
Deux jours avant, sa maman m’a appelée pour me demander si j’avais des disponibilités pour voir son fils rapidement. François finit sa 8ème Harmos et il est en épuisement neurovisuel suite à ses examens de fin de cycle. Il ne dort plus, n’a plus faim et n’arrive plus à se concentrer. De plus, il vient de perdre son deuxième grand-papa. Sa maman a pris les devants en allant chez son pédiatre pour un arrêt de travail et elle l’a interrogé sur ses besoins. François lui a demandé s’il pouvait venir à mon atelier. Après discussions, nous décidons que je le verrai quatre fois en deux semaines.
Après une prise de contact avec un squiggle, je lui parle des étapes du deuil (Kübler-Ross, Kessler). Je l’encourage aussi à parler de son grand-papa s’il en ressent le besoin. Il me dit qu’il a été à l’enterrement comme s’il avait été au cinéma. Il était tellement à bout de force qu’il n’a rien ressenti. François est épuisé ; il a accepté, avec l’aide de sa maman, d’avoir touché le fond. L’art-thérapie, avec son cadre sécurisant, va pouvoir le remettre en mouvement tout en respectant son rythme.
Les émotions et l’art thérapie
Je commence mes suivis de personnes endeuillées, enfants et adultes, en les invitant à regarder un jeu de cartes que j’ai créé et qui regroupe 29 émotions liées au deuil. Puis je leur propose de les classer en trois colonnes : oui / parfois / non. Lors du moment de partage, les participants les nomment et expliquent par une phrase dans quel contexte l’émotion apparaît. Au fur et à mesure que les personnes nomment leurs émotions, les tensions se délient.
Souvent les personnes endeuillées se sentent fatiguées et vides en arrivant à l’atelier. Lorsqu’elles prennent conscience qu’elles doivent gérer plus de 20 émotions quand elles pensent à leur proche décédé, elles réalisent qu’elles ne sont pas vides, mais saturées d’un trop plein d’émotions, comme une pelote de laine emmêlée dont on ne sait plus quel bout tirer. Ce travail est important pour mettre des mots sur le désarroi dans lequel elles se trouvent. C’est une piste parmi d’autres que j’apprécie grandement. Souvent une, deux ou trois émotions ressortent du lot et donne un point de départ pour des changements à venir.
Je propose donc ce jeu de cartes à François. Il en choisit 9 : vide, sous pression (à cause de l’école), surpris, mais aussi soulagé (que son grand-papa soit mort), angoissé, blessé, déçu, désemparé, haineux (de ne plus se reconnaître). Il est aussi surpris de n’être pas aussi vide que cela.
Les 6 émotions de base et l’art thérapie
L’émotion est axée sur quelque chose de précis. Elle est rapide et occupe le devant de la conscience. Elle entraîne aussi certaines sensations physiques. Nous avons tendance à catégoriser les émotions en étant agréables ou non, souhaitables ou non. Il est clair que toutes les émotions sont nécessaires, car elles sont des indicateurs de nos ressentis internes. Elles nous aident à choisir les actions à suivre. On parle souvent des 6 émotions de base (la joie, la colère, la tristesse, la surprise, la peur, le dégoût), mais il en existe beaucoup d’autres. C’est d’ailleurs un manque de connaissance de ce vocabulaire émotionnel qui nous empêche de nous connecter à ce qui se joue en nous. Et pourtant, cette prise en compte du message des émotions permet de comprendre ce qui les déclenche et trouver comment pouvoir y répondre de manière adaptée, afin de les dépasser.
Le moment de peinture en art thérapie
Après la discussion sur les émotions, François choisit de jouer avec la peinture. Il travaille une couleur avec une carte (de crédit), laisse sécher la feuille et poursuit sa production en la recouvrant avec une couleur de pastel gras. Il la met au mur et l’observe minutieusement pour ressentir les contrastes entre les deux couleurs choisies et pour distinguer les formes qui apparaissent. Ces moments de création ont l’air ludiques, légers et gais, et pourtant ils permettent à François de déposer sa souffrance et son mal-être. Avec les enfants, les interprétations m’échappent souvent. Cela demande un grand lâcher-prise. Je suis consciente que certaines choses se passent sans que je puisse pour autant les nommer et les interpréter : C’est une chose remarquable que l’inconscient d’un être humain puisse s’adresser à un autre inconscient sans passer par le conscient – c’est aussi un fait indéniable. (S. Freud).

Si François a pu rapidement retrouver un équilibre pour la nourriture et de l’énergie pour refaire du sport, le sommeil quant à lui, reste très fragile au bout des deux semaines de prise en charge.
Le respect des croyances : Aani et Igasho (2)
Après des jours et des jours de tristesse, il se souvint que les anciens de sa tribu parlaient d’un chemin qui conduisait au pays des âmes. Les anciens disaient qu’on pouvait trouver le chemin si on le voulait de toutes ses forces.
Alors le lendemain, Igasho remplit sa besace de provisions et il se mit en route. Il ne savait pas combien de jours il aurait à voyager. Mais si le pays des âmes existait, il le trouverait.
Le respect des croyances en thérapie : Madame J.
Mme J. prend contact avec moi pour un atelier d’art-thérapie. Elle vient de perdre son maman. Elle me précise : “j’étais très attachée à elle. Mais je sais que je pourrai faire son deuil. Je l’ai déjà fait avec ma grand-maman avec qui j’avais une excellente relation.”
Elle vient chez moi, car elle ressent de fortes angoisses par rapport à deux choses liées à son papa : l’héritage et le fait que sa maman ne soit pas partie. Deux thérapeutes qui travaillent avec l’énergie le lui ont dit.

Lorsqu’on accompagne une personne endeuillée, il est important de prendre en compte ses croyances. Elle n’est pas là pour changer de confession et en adopter une qui aurait plus de sens pour le thérapeute. C’est au thérapeute de les d’accueillir avec respect et bienveillance. La personne est-elle croyante ou athée ? Suit-elle les préceptes d’une religion ou se sent-elle attirée par une spiritualité plus philosophique ? Ou encore est-elle agnostique ? Je comprends rapidement que Mme J. croit à la réincarnation. Elle est en recherche d’une certaine spiritualité en tant que quête de sens et soigne les personnes avec son don.
Après une recherche des émotions présentes (elle en trouvera 13), je lui propose un collage. Comme le dit merveilleusement Jacques Prévert : “on peut faire des images avec des ciseaux et de la colle, et c’est pareil qu’un texte, ça dit la même chose.”
Le collage en art thérapie
Lorsque Mme J. finit son collage, nous le fixons au mur. Elle prend du recul et commence à parler. Son collage est séparé en deux parties, comme pour répondre à ses deux questions : “qu’est-ce qui retient ma maman sur terre ?” Et “comment avoir le temps pour valoriser l’héritage de mes parents ?”
La réponse à la première question lui saute aux yeux : une grande bougie occupe une bonne partie de la feuille : “dès que je pense à elle, j’ai pris l’habitude d’allumer une vieille bougie à la cuisine. Je suis persuadée que c’est cela qui la fait revenir.”
Pour la deuxième question, elle trouve la solution après avoir observé son collage dans tous les sens. Pour elle, la solution est claire : elle a besoin d’un matin de plus dans la semaine pour s’occuper du patrimoine familial. Mme J. est soulagée. Elle me remercie pour l’accompagnement et est impressionnée par la force de la méthode du collage qu’elle pratique pour la première fois.
Le business de la mort : Aani et Igasho (3)
Au moment du départ, il fut bien embarrassé. Quelle direction prendre ? Il finit par se rappeler que les anciens parlaient du sud. Plein de courage et d’espoir, Igasho se mit en route, armé de son arc et de ses flèches et suivi de son chien. Il marcha longtemps, longtemps. Le paysage ressemblait à celui de son pays. C’était une succession de forêts, de collines, de rochers. Il y avait seulement un peu moins de neige.
Puis la neige laissa la place à de grandes étendues d’herbe. Des fleurs s’épanouissaient un peu partout autour de lui. Dans le ciel sans nuage, des oiseaux volaient en chantant
– C’est la bonne route, pensa-t-il.
Bientôt, il escalada une haute falaise, et il aperçut une cabane. Devant la porte se tenait un vieillard appuyé sur une canne :
– Je t’attendais, lui dit le vieil homme. Je sais ce qui t’amène. Celle que tu cherches s’est reposée dans ma cabane.
En entendant ces mots, Igasho se mit à trembler d’impatience. Il demanda au vieillard le chemin à prendre. Le vieil homme répondit :
– Regarde cette étendue d’eau là-bas et ces plaines vertes et bleues. C’est le pays des âmes. Si tu veux y pénétrer, abandonne ton corps, ton arc, tes flèches et ton chien. Je les garderai en ton absence.
Le business de la mort : tout et son contraire
La mort, c’est aussi une histoire de business… On l’entrevoit dans le monde très fermé et méconnu des croque-morts que M. Edmond Pittet, Patrice Rossel (1992) et François Vorpe (2012) relatent très bien dans leurs livres, on le devine avec les entreprises qui proposent aux personnes âgées de construire leur cercueil, ou avec celles qui vendent des cercueils en carton moins chers et biodégradables.
Il existe aussi des entreprises qui créent des diamants avec les cendres du défunt, ou celles qui stockent, dans des caissons réfrigérés, des corps (ou des têtes) cryogénisés de personnes désireuses d’échapper à la mort en étant réanimées par les futurs progrès de la technologie. Il existe également un business en Amérique du Nord qui permet à une personne vivante d’assister à son propre enterrement et d’entendre ce que ses proches pensent de lui.
Toutes ces anecdotes proviennent d’articles, de brèves, de sites trouvés par sérendipité. Elles sont le témoin de pratiques nouvelles, entre fantasme et besoin de donner un sens à la mort, mais aussi intrinsèquement au mystère de l’après-mort.

Mon intérêt pour la mort en art thérapie
C’est pourtant aussi ce que je propose dans mes ateliers d’art-thérapie : cheminer dans le travail du deuil pour donner du sens à la mort de la personne aimée. Ferais-je donc aussi du business ?
Mon intérêt pour la mort ne date pas d’hier. Petite, j’aimais visiter les cimetières. A 30 ans, je suis la formation accompagnement des personnes en fin de vie proposée par Caritas. Puis je fonctionne en tant que bénévole dans des hôpitaux de la région de Lausanne jusqu’à la naissance de mon premier fils. Et j’accompagnerai plus tard mes grands-parents et ma belle-maman.
Je me suis souvent posé la question de cet intérêt … Recherche d’expériences pour être moins surprise le moment venu ? Un baume pour calmer mes peurs ? Ou un acte désespéré pour apprivoiser la Mort ? Ou mon intérêt date-t-il du jour où j’ai pris conscience de mon statut de mortel ? Pendant une interview, Laurent Goumelle disait : « On peut rester dans une espèce d’illusion d’immortalité, mais un jour, la vie nous rattrape et nous met face à la réalité”.
Le deuil qui ne se fait pas : Aani et Igasho (4)
Le jeune homme obéit. Et soudain il se sentit léger comme l’air. Plus il avançait vers le pays des âmes, plus le parfum des fleurs et le chant des oiseaux étaient doux. Une brume rose l’entoura. La brise se fit tiède.
Bientôt, Igasho s’aperçut que les arbres s’éloignaient. Il lui semblait traverser les rochers et les collines sans les toucher. En vérité, ce n’étaient des arbres, ni des rochers, ni des collines, mais seulement leur souvenir. Igasho étaient au pays des âmes.
C’est ainsi qu’il atteignit les bords du grand lac. Au milieu, il y avait une grande île verte et bleue. Devant lui, un étrange canoë de pierre et une pagaie l’attendaient. Le jeune chef sauta aussitôt dans le canoë et se dirigea vers l’île. Et là, il aperçut la jeune fille. Elle était assise sur la rive. Dès qu’elle le vit, elle sauta aussi dans son canoë. (…) Ils débarquèrent sur l’île. Et ils marchèrent main dans la main. Ils n’avaient ni soif, ni faim, ni trop froid, ni trop chaud. Le jeune chef ne pensait plus à la guerre ni à la chasse. Les amoureux voulaient rester là, ensemble pour l’éternité.
Le deuil qui ne se fait pas : Mme S.
Mon téléphone sonne et je décroche. Mme S. me demande si je suis bien l’art-thérapeute qui propose des suivis de personnes en deuil. Je lui réponds par l’affirmative et elle m’explique son parcours avec une voix tremblotante Elle avait dû pleurer avant d’oser m’appeler.
En thérapie depuis des années, avec plusieurs psychologues, elle a changé un suivi avec une psychiatre spécialisée en traumatologie depuis une année. Sa thérapeute vient de lui fixer un ultimatum : “cela fait une année que vous venez me voir pour me parler du deuil de votre frère et chaque fois que je vous parle de lui, vous mettez les mains sur les oreilles et vous secouez la tête. Cela remet fortement cette thérapie en doute.” C’est sûrement la première thérapeute qui la met au pied du mur ; cela demande du courage et une grande confiance en son travail.

Mme S. est sûre, elle ne veut pas en parler, mais elle veut aller mieux. Ses crises d’angoisse l’épuisent et elle a l’impression de devenir folle. Ses nuits blanches ne font qu’accentuer son mal-être et son manque de ressources. Elle m’explique qu’une connaissance lui a parlé de moi : “vous pensez que je pourrais venir vous parler de ce deuil … sans mot ?”
C’est la deuxième fois que l’on me fait cette demande. Un souvenir me traverse l’esprit. Lorsque j’étais médiatrice scolaire, une fille de 9 ans avait pris rendez-vous avec moi quatre jours après le suicide de son père : “je ne veux pas en parler, mais je veux aller mieux. Pouvez-vous m’aider ?”
Premier atelier d’art-thérapie
Lors du premier atelier d’art-thérapie, après avoir fait un squiggle ensemble pour faireconnaissance et faire ressortir son potentiel créatif, nous fixons trois dates. Je lui propose aussi de rajouter un critère dans le cadre thérapeutique, qui délimite un extérieur et un intérieur. Un critère qui me paraît primordial : celui de pouvoir montrer et raconter les diverses productions à la psychiatre qui la suit. Je vois l’art-thérapie comme un levier. Ce seront des expérimentations autour de son deuil pour retravailler certaines choses pas comprises, mal vécues ou qu’elle aurait voulues autrement. Je lui propose de se mettre en mouvement et de commencer une mise en mot.
Je ne lui demanderai pas de faire le récit de sa vie – ce qu’elle a dû déjà faire maintes fois avec ses thérapeutes – mais de faire une photographie actuelle de ce deuil. Mme S. me dit se sentir seule, que beaucoup de choses du quotidien la heurtent et qu’elle a peur que personne ne puisse la comprendre. Elle donne très clairement la définition du blocage émotionnel.
Elle m’explique succinctement l’accident de voiture de son frère, brutal, au début de leurs vies d’adulte, sans possibilité de se dire au revoir. Il y a 20 ans. Lors du premier atelier, nous allons chercher les émotions présentes encore aujourd’hui. Elle en trouve 23, alors qu’au début de la prise en charge, elle se sentait vide. Elle ressent encore beaucoup de culpabilité : “et si je l’avais attendu après le travail ?” Mme. S. pleurera souvent pendant nos trois rencontres.
Deuxième atelier d’art-thérapie
Pendant le deuxième atelier, je lui propose de faire un collage qui parle d’elle lorsqu’elle pense à son frère. Mme S. voit, dans sa production, certaines barrières qui l’empêchent d’avancer, mais aussi l’amour de son frère et l’espoir.
Elle me raconte l’enterrement : son père, sa mère et sa tante serrés ensemble et elle derrière. Elle me racontera l’absence de pleurs. Selon Rosette Poletti, une cérémonie inexistante ou qui n’a de sens, peut être préjudiciable pour la personne endeuillée.
Troisième atelier d’art-thérapie
Lors du troisième atelier, je lui mets à disposition un concept qui lui permet de revivre un enterrement comme elle l’aurait voulu dans un bac à sable avec des Playmobil.
Selon Rosette Poletti, “un retard au démarrage ou une absence apparente de souffrance (déni) ou une hyperactivité considérable sont les signes d’un deuil pathologique. Les signes apparaîtront plus tard par une somatisation. Lorsque “le moi” n’est pas assez fort, il existe un risque de confusion avec le mort, ce qui peut amener au suicide ou à une pathologie hypocondriaque. La personne s’identifie tellement à celui qui est mort, qu’il ressent les mêmes douleurs. Et grâce à ces douleurs, on se rapproche du mort, on est encore en contact.” Les morts brutales peuvent favoriser les deuils pathologiques.
Le respect du rythme de chacun : Aani et Igasho (5)
Mais Igasho entendit le doux murmure du vent et il reconnut la voix du Maître de la Vie qui lui dit :
– Il faut que tu retournes d’où tu viens, car ta tribu te réclame, et tu dois la conseiller. Retourne à la cabane du vieillard. Tu reprendras ton corps, tu retrouveras ton arc, tes flèches et ton chien, et tu rentreras dans ton pays. Les années passeront. Sois patient et calme. Quand le temps sera venu, tu viendras rejoindre celle que tu aimes. Elle est sous ma protection, elle restera jeune et belle.
Le jeune chef était triste de quitter celle qu’il aimait. Mais il devait reprendre la route du monde. Il retrouva le vent, la neige, le froid et les hommes. Il conduisit ses frères, il chassa avec eux et fit la guerre. Et peu à peu, il aima de nouveau la vie.
Il l’aima beaucoup. Plus tard, bien plus tard, quand le temps fut venu, il reprit le chemin du pays des âmes pour y retrouver celle qu’il n’avait jamais oubliée.
Le Maître de la Vie l’accueillit. Sa bien-aimée l’attendait.
Le respect du rythme de chacun en art thérapie: une famille endeuillée
Ce samedi matin, j’accueille une famille endeuillée. Une dame est décédée subitement à l’âge de 86 ans et sa fille Marianne est très inquiète pour ses deux filles et surtout pour sa petite-fille de 9 ans. Depuis l’annonce du décès, cette dernière a beaucoup de peine à s’endormir et finit systématiquement dans le lit de ses parents au milieu de la nuit.
Je vais accompagner trois générations : Marianne, la fille de la personne décédée, qui a offert à ses deux filles, Agnès et Odile et ses deux petits-enfants Marion et Valentin, un atelier d’art-thérapie. Trois adultes et deux enfants de 7 et 9 ans.

Accompagner des enfants et des adultes sur leur chemin du deuil ne se fait pas avec les mêmes médiums, ni les mêmes mots ou encore les mêmes rythmes. Ils n’ont pas les mêmes besoins, ni les mêmes façons d’élaborer la mort. Par rapport à l’âge de ces deux enfants, je suppose qu’ils ont intégré que la mort est irréversible, mais que leurs pensées restent magiques et animistes. S’ils conçoivent le défunt mort, ils se préoccupent encore de son devenir en pensant qu’il voit, sent, entend, etc. Ils ont pris aussi conscience que leurs parents peuvent décéder à tout moment.
Il est dès lors très important de proposer à ces trois générations des moments de création en groupe (pour qu’ils puissent ressentir le soutien de leur clan) et des moments de création séparés. Il est aussi primordial d’élaborer un cadre horaire très précis, afin que chacun ait sa place et soit respecté dans ses temps de création et de parole.
En une heure trente, chacun a eu son moment pour déposer sa peine.
Conclusion
J’ai relaté quatre suivis, quatre thérapies brèves, quatre façons d’accompagner des enfants, des adultes et des familles.
Ces ateliers d’art-thérapie, je les pense comme un espace pour continuer à vivre : un espace de rêverie et de mise en mouvement du corps, des émotions et de la conscience. Un espace pour donner la place aux larmes, aux sourires, aux soupirs, aux souvenirs d’autres deuils…. Un espace pour donner aux personnes endeuillées la possibilité d’intégrer la mort dans leur vie.
Beaucoup d’œuvres, qu’elles soient liées à la musique, au chant ou aux arts visuels, ont été créées pendant des temps de deuil. L’expression créatrice transcende la douleur de la perte en partage, en espoir et lui donne du sens.
Les processus art-thérapeutiques placent les endeuillés en position d’acteurs de leur existence… afin que leur vie reprenne des couleurs. En vous engageant dans cette pratique, vous découvrirez une connexion profonde avec vous-même et avec le défunt.
La mort s’invite dans notre vie … toujours trop tôt… et opère des transformations profondes. Pour nous y préparer, commençons déjà par nous poser ces quatre questions :
Quelles sont mes peurs face à ma mort ?
Quelles sont mes peurs face à la mort de mes proches ?
Comment dessinerais-je la mort ?
Comment est-ce que j’aimerais mourir ?

